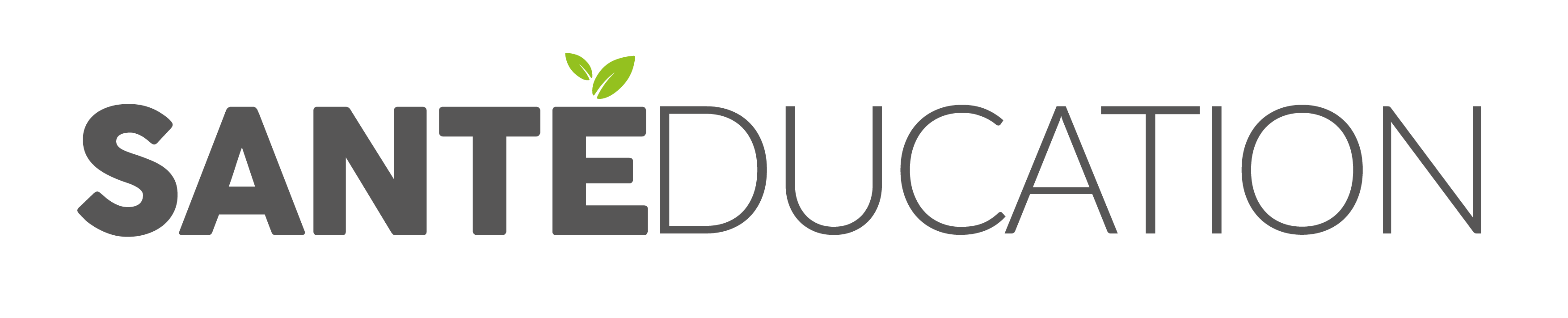Solitude : une alarme de déconnexion
- Posted on 19/08/2025 18:27
- Film
- By kolaniyendoumiesther@gmail.com

Extrait de l'article: Il arrive, sans même s’en apercevoir, que le monde autour de soi rétrécisse petit à petit. Moins de pas dans les rues, moins de jours au bureau, des rendez-vous entre amis qui s'annulent, des discussions qui se délitent dans un fil de messages...
Il arrive, sans même s’en apercevoir, que le monde autour de soi rétrécisse petit à petit. Moins de pas dans les rues, moins de jours au bureau, des rendez-vous entre amis qui s'annulent, des discussions qui se délitent dans un fil de messages sans suite. Parfois, les projets s’effondrent doucement, les invitations se font rares, et fixer une simple date pour se revoir devient un véritable casse-tête. Sans le vouloir, un certain vide peut s’installer. Un léger malaise émotionnel, une fatigue inhabituelle ou un sentiment diffus de déconnexion. Serait-ce de la solitude ? Sûrement, cela peut-être.
La
solitude n’est pas une étiquette que l’on revendique facilement. Beaucoup
continuent à croire qu’il suffit d’avoir des amis ou d’être en couple pour en
être épargné. Pourtant, elle peut frapper n’importe qui, à tout moment.
Comprendre
la solitude
La
solitude n’est pas simplement l’absence de personnes autour de soi. Elle naît
surtout du décalage entre les relations vécues et les besoins ressentis, tant
en quantité qu’en qualité. C’est une sensation profondément subjective. Il est
possible de se sentir seul au milieu d’une foule, ou parfaitement bien en étant
seul chez soi.
Parfois,
la solitude s’installe lentement, presque imperceptiblement. Ce n’est qu’une
fois qu’elle devient persistante qu’elle se révèle.
Signes
à ne pas ignorer
La
solitude peut se manifester de nombreuses façons. Sur le plan physique, un
froid intérieur, un sentiment de vide ou même une douleur diffuse peuvent
apparaître. Des recherches montrent d’ailleurs que la douleur émotionnelle
provoquée par la solitude est perçue dans le cerveau de manière similaire à une
douleur physique.
Certains
changements de comportement peuvent également alerter, tels que des routines
qui changent, des troubles du sommeil, des variations d’appétit, un désintérêt
pour des activités jadis plaisantes.
La
solitude peut entraîner une tristesse persistante, de la fatigue inexpliquée, une
impression de ne pas appartenir au groupe, même en étant entouré, une
hypersensibilité à la critique ou au rejet.
Mais
il est essentiel de rappeler que ressentir de la solitude ne signifie pas être
brisé.
La
solitude est une réponse normale à la déconnexion. Selon le neuroscientifique
John Cacioppo, elle joue le rôle d’un système d’alarme évolutif. Dans les temps
anciens, être séparé de sa tribu signifiait un danger. Le cerveau développe donc
un mécanisme pour signaler cette séparation et inciter à recréer du lien. En ce sens, la solitude n’est pas une faiblesse mais un signal. Un appel à la connexion.
Il est difficile d’en parler
Malheureusement,
la solitude reste encore très stigmatisée. Il existe une honte implicite à
l’admettre, notamment chez les hommes. Beaucoup n’osent pas dire qu’ils se
sentent seuls, de peur d’être perçus comme faibles ou rejetés. Ce silence alimente le problème. Plus personne n’en parle, plus la solitude se normalise et s’aggrave.
Effets sur la santé
Lorsqu’elle
s’installe dans la durée, la solitude peut avoir des conséquences sérieuses sur
la santé. Selon les études, la solitude chronique peut entraîner la dépression,
l’anxiété, l’affaiblissement du système immunitaire, les maladies
cardiovasculaires, le risque accru de décès prématuré.
La
solitude peut aussi devenir un cercle vicieux : en s’y habituant, une vision
négative du monde s’installe. On s’attend au rejet, on évite les autres, et
l’isolement se renforce.
Entouré
et solitaire
Même
en ayant un mari ou une femme, des amis ou un travail enrichissant, un
sentiment de solitude peut persister. Car ce n’est pas le nombre de relations
qui compte, mais leur sens. Ce qui manque parfois, c’est une connexion plus
profonde, un objectif commun, une identité partagée, ou simplement le sentiment
d’avoir sa place dans un groupe. Il ne s’agit pas d’ingratitude ou de faiblesse. Il s’agit de besoins humains fondamentaux.
Que faire alors ?
La
première étape est de s’interroger : quelles connexions manquent vraiment ?
Est-ce une amitié plus intime ? Un groupe où partager ses passions ? Une
mission commune ?
Repérer
ce qui a fonctionné auparavant peut aider. Un club de lecture, un groupe de
sport, un engagement dans une association, une simple conversation régulière
avec le voisin ou le commerçant du quartier peuvent parfois suffire à rallumer
quelque chose.
Si l’effort semble difficile à faire seul, un professionnel (psychologue,
thérapeute) peut proposer des stratégies adaptées pour créer ou renforcer des
liens.
Les
causes structurelles de la solitude
La
solitude n’est pas toujours le fruit d’un parcours individuel. Elle est aussi
structurée par la mauvaise planification des quartiers, les inégalités sociales,
les conditions de travail, les normes culturelles, la longue durée d’une
pandémie, et même le changement climatique (canicules, catastrophes,
déplacements).
La
solitude ne signifie pas simplement être seul, elle prend racine dans l’isolement social imposé par un
environnement inhospitalier.
Raymond DZAKPATA
Source :
« The conversation »